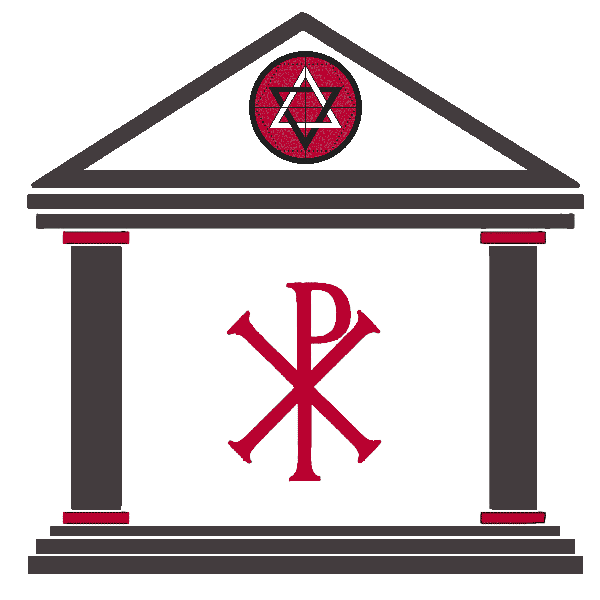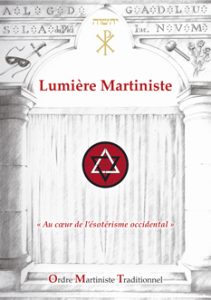Par Jean-Baptiste-Modeste Gence ♦
Extrait de Sursum Corda, trois entretiens sur les sciences secrètes, édition DR, 2003.
Louis-Claude de Saint-Martin, savant et profond spiritualiste, dit le Philosophe Inconnu, naquit à Amboise, d’une famille noble, le 18 janvier 1743. Il dut à une belle-mère attentive les premiers éléments de cette éducation douce et pieuse, qui le fit, disait-il, aimer, pendant toute sa vie, de Dieu et des hommes. Au collège de Pont-Levoy, où il avait été mis de bonne heure, le livre qu’il goûta le plus fut celui d’Abadie, intitulé L’Art de se connaître soi-même : c’est à la lecture de cet ouvrage qu’il attribuait son détachement des choses de ce monde. Mais destiné par ses parents à la magistrature, il s’attacha, dans son cours de droit, plutôt aux bases naturelles de la justice qu’aux règles de la jurisprudence, dont l’étude lui répugnait. Aux fonctions de magistrat, auxquelles il eût cru devoir donner tout son temps, il préféra la profession des armes, qui, durant la paix, lui laissait des loisirs pour s’occuper de méditations et de la connaissance de l’homme. Il entra comme officier, à vingt-deux ans, au régiment de Foix, en garnison à Bordeaux.
Malgré son goût pour la philosophie interne, une carrière non moins active que celle des exercices militaires s’ouvrit à lui. Initié par des formules, des rites, des pratiques, à des opérations qu’on appelait théurgiques, et que dirigeait Martinez Pasqualis (voyez la Biographie universelle), chef de la secte dite des Martinistes, il lui demandait souvent : « Maître, eh quoi ! faut-il donc tout cela pour connaître Dieu ? » Cette voie, qui était celle des manifestations sensibles, n’avait point séduit notre philosophe. Ce fut toutefois par là qu’il entra dans la voie du spiritualisme. La doctrine de cette école, dont les membres prenaient le titre hébreu de cohen (« prêtres »), et que Martinez présentait comme un enseignement public secret dont il avait reçu la tradition, se trouve exposée, d’une manière mystérieuse, dans les premiers ouvrages de Saint-Martin, et surtout dans son Tableau naturel des rapports entre Dieu, l’homme et l’univers.
Après la mort de Martinez, l’école fut transférée à Lyon. C’est là que, muni des armes d’une doctrine opposée à celle des Encyclopédistes qui ne menaçait que trop de se propager, Saint-Martin, destiné en quelque sorte à combattre l’athéisme philosophique, comme il devait un jour attaquer de front le matérialisme révolutionnaire, publia son livre Des erreurs et de la vérité. En détruisant les doctrines erronées d’une prétendue philosophie de la nature et de l’histoire, il rappelle l’homme à la vérité fondée sur le principe même de la science et sur la nature de l’être intellectuel ; mais il n’emploie les traditions de l’Écriture qu’à l’appui des preuves, ou énigmatiquement, pour ne pas trop heurter les lecteurs imbus des théories sorties de l’atelier du baron d’Holbach. Cette même école de Pasqualis, dont les opérations cessèrent en 1778, vint se fondre à Paris dans la société des G. P., ou dans celle des Philalèthes, professant en apparence la doctrine de Martinez et celle de Swedenborg, mais cherchant moins la vérité que le grand œuvre. Saint-Martin fut invité, en 1784, à cette dernière réunion ; mais il refusa de participer aux opérations de ses membres, qu’il jugeait ne parler et n’agir qu’en purs francs-maçons, et non en véritables initiés (c’est-à-dire unis à leur Principe).
Saint-Martin suivait volontiers les réunions où l’on s’occupait, de bonne foi, d’exercices qui annonçaient des vertus actives. Les manifestations d’un ordre intellectuel, obtenues par la voie sensible, lui décelaient, dans les séances de Martinez, une science des esprits ; les visions de Swedenborg, d’un ordre sentimental, une science des âmes. Quant aux phénomènes du magnétisme somnambulique qu’il suivit à Lyon, il les regardait comme étant d’un ordre sensible inférieur ; mais il y croyait. Dans une conférence qu’il eut avec Bailly, l’un des commissaires-rapporteurs, pour lui persuader l’existence d’un pouvoir magnétique sans soupçon d’intelligence de la part des malades, il raconte qu’il cita des opérations faites sur des chevaux que l’on traitait alors par ce procédé. Bailly lui répondit : « Que savez-vous si les chevaux ne pensent pas ? »
Amateur de tout ce qui pouvait lui faire reconnaître une vérité, surtout dans les sciences soumises à des principes exacts, l’étude des mathématiques dont Saint-Martin s’occupait pour y découvrir l’esprit que pouvait receler la connaissance des nombres, occasionna sa liaison avec Lalande ; mais ils étaient trop antipathiques : elle dura peu. Quoiqu’il ne crût pas à son athéisme, il le voyait néanmoins placé de manière à s’enfoncer de plus en plus dans ce système. Notre philosophe s’estimait avoir plus de rapports avec J.-J. Rousseau, qu’il avait étudié. Il pensait, comme lui, que les hommes étaient naturellement bons : mais il entendait, par la nature, celle qu’ils avaient originairement perdue, et qu’ils pouvaient recouvrer par leur intention ; car il les jugeait, dans le monde, plutôt entraînés par l’habitude vicieuse que par la méchanceté. À cet égard, il ressemblait peu à Rousseau, qu’il regardait comme misanthrope par excès de sensibilité et voyant les hommes non tels qu’ils étaient, mais tels qu’il voulait qu’ils fussent.
Quant à lui, au contraire, il aima toujours les hommes, comme meilleurs au fond qu’ils ne paraissaient être ; et les charmes de la bonne société lui faisaient imaginer ce que pouvait valoir une réunion plus parfaite dans ses rapports intimes avec son Principe. Aussi ses occupations, comme ses plaisirs, furent toujours conformes à cette disposition. La musique instrumentale, des promenades champêtres, des conversations amicales, étaient les délassements de son esprit ; et des actes de bienfaisance, ceux de son âme. Il n’avait rien à lui, tant qu’il lui restait quelque chose à donner ; et il recevait toujours en satisfaction plus qu’il ne donnait. Dans ses entretiens, il trouvait aussi toujours à gagner. C’est même à ses liaisons avec des personnages des plus distingués par leur rang (tels que le marquis de Lusignan, le maréchal de Richelieu, le duc d’Orléans, la duchesse de Bourbon, le chevalier de Bouflers, etc.), qui trouvaient avec raison son spiritualisme trop élevé pour l’esprit du siècle, qu’il dit avoir dû la confirmation et le développement de ses idées sur les grands objets dont il cherchait le Principe, en s’entretenant avec lui-même et avec les personnes les moins prévenues. Il voyagea, dans cette vue, comme Pythagore, pour étudier l’homme et la nature, et pour confronter le témoignage des autres avec le sien. C’était à lui que pouvait plus réellement s’appliquer la devise de Jean-Jacques : Vitam impendere vero. Tout entier à la recherche de la vérité, le but constant de ses études et de ses ouvrages, Saint-Martin quitta enfin le service militaire pour se livrer tout à fait à son objet, et au ministère, en quelque sorte spirituel, auquel il se sentait appelé.
Ce fut à Strasbourg que, par l’organe d’une amie (Mme Boecklin), il eut la connaissance des ouvrages du philosophe teutonique Jacob Boehme, regardé en France comme un visionnaire ; et il étudia dans un âge avancé la langue allemande, afin d’entendre et de traduire pour son usage, en français, les ouvrages de cet illuminé célèbre, qui lui découvrirent ce que, dans les documents de son premier maître, il n’avait fait qu’entrevoir. Il le regarda toujours depuis comme la plus grande lumière humaine qui eût paru. Saint-Martin visita l’Angleterre, où il se lia, en 1787, avec l’ambassadeur Barthélemy, et connut William Law, éditeur d’une version anglaise et d’un précis des livres de Jacob Boehme. En 1788, il fit un voyage à Rome avec le prince Alexis Gallitzin, qui dit à M. Fortia d’Urban ce mot remarquable : « Je ne suis véritablement un homme que depuis que j’ai connu M. de Saint-Martin. » De retour de ses excursions en Italie, en Allemagne et en Angleterre, il ne put se défendre d’accepter la croix de Saint-Louis, dont il ne se croyait pas digne, quoiqu’il la dût plus à la noblesse de ses sentiments qu’à ses services.
La Révolution, dans ses diverses phases, trouva Saint- Martin toujours le même, toujours allant droit à son but : Justum et tenacem propositi virum. Élevé par ses principes au-dessus des considérations de la naissance ou de l’opinion, il n’émigra point ; et, tout en ayant horreur des désordres et des excès, soit de l’anarchie, soit du despotisme, il vit les desseins terribles de la Providence dans la Révolution française, et crut voir un grand instrument temporel dans l’homme qui vint plus tard la comprimer. C’est à l’époque de 1793, où l’esprit de famille semblait être, comme la société, en dissolution, que Saint- Martin alla donner ses soins constants et rendre les derniers devoirs à un père infirme et paralytique. En même temps, malgré l’état de gêne que sa modique fortune, dans cette circonstance, lui faisait éprouver, il contribuait, en qualité de citoyen, aux besoins publics de sa commune. De retour dans la capitale, mais compris bientôt dans le décret d’expulsion du 27 germinal an II contre les nobles, il se résigna et quitta Paris.
Pendant que la plupart des hommes s’occupaient des intérêts politiques qui agitaient les nations, il correspondait sur des objets élevés et abstraits, mais importants par leur influence sur la destinée et la nature de l’homme, avec un baron suisse, membre du conseil souverain de Berne (voir « Kirchberger » dans la Biographie universelle). Vivant solitaire, séparé de ses connaissances, au milieu d’une mer de passions orageuses, il se regardait, dans son isolement, comme le Robinson Crusoé de la spiritualité. Cependant, une prétendue conjuration d’une association religieuse, sous le nom de la Mère de Dieu, étant alors exposée devant la justice révolutionnaire, il ne fut point à l’abri d’un mandat d’arrêt.
Heureusement, le 9 Thermidor survint. Sa correspondance avec le baron suisse, naturaliste et philosophe religieux, qui, porté vers les manifestations extérieures et sensibles, le questionnait sur ces matières, aurait pu le faire suspecter : le philosophe spiritualiste, à la vérité, ramenait toujours son ami au sens moral et intérieur, et le renvoyait à son chérissime Boehme. Ils se lièrent intimement, sans jamais se voir ; et ils s’échangèrent réciproquement leurs portraits. Durant le discrédit total des assignats, le Français accepta du Suisse, mais seulement en dépôt, l’offre d’une somme en numéraire, dont sa philosophie, ou plutôt la foi évangélique, lui avait appris à pouvoir se passer. Tout en estimant la fermeté de Jean-Jacques, il trouvait peu séant dans la bouche d’un
homme qui prêchait tant la bienfaisance, d’en arrêter le libre cours en refusant les dons. Saint-Martin, de son côté, offrait généreusement au Suisse, dont la maison de Morat fut pillée lors de l’invasion française, plusieurs pièces d’argenterie qui lui restaient.
Fidèle à ses devoirs publics comme à ceux de l’amitié, il acquittait alors personnellement son service dans la garde nationale. Il nous apprend qu’il montait la sienne, en 1794, au Temple, où était détenu le fils de Louis XVI. On l’avait compris, trois ans auparavant, sur la liste des candidats pour le choix d’un gouverneur du Dauphin. En mai 1794, chargé de dresser l’état de la partie donnée à sa commune des livres provenant des dépôts nationaux, ce qui l’intéressa surtout, c’est qu’il y trouva des richesses spirituelles dans une Vie de la sœur Marguerite du Saint-Sacrement.
Vers la fin de la même année, quoique sa qualité de noble lui interdît le séjour de Paris jusqu’à la paix, il fut désigné par le district d’Amboise comme un des élèves aux Écoles normales destinées à former des instituteurs pour propager l’instruction. Après avoir, comme Socrate, consulté son génie, Saint-Martin accepta cette mission, dans l’espérance, disait-il, qu’il pourrait, à l’aide de Dieu, en présence de deux mille auditeurs animés de ce qu’il appelait le spiritus mundi, déployer utilement son caractère de spiritualité religieuse, et combattre avec succès le philosophisme matériel et anti-social. Requis de rentrer dans la capitale, il y vint en effet tout à propos pour défendre et développer la cause du sens moral, contre le professeur de la doctrine du sens physique ou de l’analyse de l’entendement humain. La pierre qu’il jeta, ce sont ses termes, au front de l’analyste-philosophe, ne fut point perdue ; et elle retentit encore dans les débats dont le souvenir nous est resté (Correspondance inédite de Saint-Martin avec Kirchberger, 19 mars 1795).
Retourné paisiblement et avec honneur dans son département, il fit partie en 1795 des premières assemblées électorales, mais il ne fut membre d’aucun corps législatif. La paix entre la France et la Suisse rendit plus active avec Berne sa relation, qui lui servit d’intermédiaire pour une autre correspondance de prédilection à Strasbourg, suspendue par les circonstances. C’était aussi, plus que jamais, entre les deux amis, un commerce d’explications pour l’un sur le texte de Jacob Boehme, et d’éclaircissements pour l’autre sur la doctrine de Saint-Martin. Les écrits de notre philosophe en avaient besoin, même ceux où il paraît plus clair, et où les traits de lumière qu’il fait jaillir laissent quelquefois désirer qu’il se montre plus à découvert.
Au milieu d’une révolution au sujet de laquelle il disait, dans son langage spiritualiste, que la France avait été visitée la première et très sévèrement parce qu’elle avait été la plus coupable, il osa émettre des principes bien différents de ceux qui étaient alors professés, quoiqu’il donnât l’exemple de la soumission à l’ordre établi. Dans son Éclair, entre autres, sur l’association humaine, il montre la base lumineuse de l’ordre social dans le régime théocratique comme le seul vraiment légitime. Mais il n’avait nullement en vue de fonder une secte. Ses écrits anonymes étaient toujours ceux du Philosophe Inconnu : il les distribuait à quelques amis, et leur recommandait le secret. Ses motifs, en remontant à Dieu comme principe de l’autorité, étaient simplement de ramener les hommes, depuis la houlette jusqu’au sceptre, à cette unité de principe dont le pâtre et le prince devaient trouver la loi en eux-mêmes, sans avoir besoin de recourir à aucun livre, ni même aux siens.
La vue intérieure et recueillie par laquelle l’homme cherche à opérer en lui la connaissance du principe même des réalités, vue bien supérieure à l’intuition purement rationnelle de Kant, est l’idée qui finit par dominer dans les écrits de l’auteur, dans celui même de la forme la moins grave, sous laquelle il a dérobé sa philosophie, lorsque le sujet pouvait prêter à la satire. Un ton de gaieté, qui lui échappe et qu’il se reproche, était plutôt dans son humeur que dans son tour d’esprit méditatif, et dans son caractère porté à la bonhomie. Il avait lu également les Méditations de Descartes et les ouvrages de Rabelais. Il aimait d’autant plus à visiter les lieux où ils avaient pris naissance, que leur contrée était aussi la sienne. On explique ainsi comment sa gravité avait pu se dérider en composant à la fois Le Ministère de l’Homme-Esprit, ouvrage des plus sérieux comme des plus élevés, et Le Crocodile, poème grotesque des plus bizarres, même après Rabelais : c’est une fiction allégorique, qui met aux prises le bien et le mal, et qui couvre, sous une enveloppe de féerie, des instructions et une critique dont la vérité trop nue aurait pu blesser des corps scientifiques et littéraires. Au milieu de ce roman énigmatique et obscur, se trouvent quatre-vingts pages d’une métaphysique lumineuse et profonde concernant la question de l’influence des signes sur la formation des idées, proposée par l’Institut. La discussion de cette question amène des résultats singuliers, par les notions tirées en partie de l’ordre spirituel auxquelles elle touche, telles que le désir, antérieur ou supérieur à l’idée, etc. ; notions qu’il appuie des plus puissants motifs.
À cette époque, les vues et les sentiments élevés qui lui faisaient admirer son bon philosophe allemand, se répandaient jusque dans les questions de l’ordre naturel qu’il traitait. D’après ses aperçus devenus plus féconds, porté à découvrir, sous la nature temporelle et visible, un monde intérieur et invisible qu’elle devait manifester selon lui par la culture à l’homme intellectuel et moral, il ne pouvait rester étranger à aucune science. Il suivait le progrès des découvertes dans chaque genre de connaissances, et en comparait les données avec celles qu’il avait acquises dans Jacob Boehme et par ses propres réflexions. C’est en fouillant ainsi dans un monde inconnu qu’il composa et produisit L’Esprit des choses, où il s’efforce de soulever un coin du voile, et de jeter quelques lueurs sur une nature qui lui semblait n’avoir été dévoilée, par une sorte d’inspiration, que pour les regards de Boehme. On conçoit, dans cette hypothèse, que les sciences, dont il avait parcouru le cercle, étant alors bien moins avancées qu’aujourd’hui, si l’on excepte ce que la connaissance de l’homme intérieur avait pu lui révéler par la méditation, il a dû rester en arrière dans plusieurs de ses explications qui ne s’accordent pas toujours avec les nouvelles découvertes, indépendamment de ce qu’elles s’éloignent nécessairement des opinions reçues.
Malgré l’étendue de ses connaissances et l’originalité de ses idées qui lui faisait tout ramener à son spiritualisme, on admirait dans Saint-Martin un sens droit et une modestie simple et aimable. Son caractère liant et son esprit communicatif lui eussent acquis sans doute beaucoup de partisans ; mais il ne cherchait point à faire des prosélytes : il ne voulait que des amis qui fussent disciples, non simplement de ses livres, mais d’eux-mêmes. Il tenait un journal de ses liaisons ; et, de même que les traductions de son cher philosophe étaient des provisions pour ses vieux jours, il regardait ses nouveaux amis comme des acquisitions, et il se jugeait très riche en rentes d’âmes. À voir son air humble et son extérieur simple, on ne soupçonnait ni la science profonde, ni les lumières extraordinaires, ni les hautes vertus qu’il recelait. Mais la candeur, la paix de ses entretiens, et, l’on ose dire, l’atmosphère de bienfaisance qui semblait se répandre autour de lui, manifestaient l’homme sage et le nouvel homme qu’avaient formé la philosophie et la religion.
Les amis de la morale aimeront à se rappeler une conversation qu’eut M. de Gérando avec notre philosophe sur les spectacles (Archives littéraires, n° III, 1804). Saint-Martin les avait beaucoup aimés. Souvent, pendant les quinze dernières années de sa vie, il s’était mis en route pour jouir de l’émotion que lui promettait la vue d’une action vertueuse mise en scène par Corneille ou Racine. Mais en chemin, la pensée lui venait que ce n’était que l’ombre de la vertu dont il allait acheter la jouissance ; et qu’avec le même argent il pouvait en réaliser l’image. Jamais il n’avait pu, disait-il, résister à cette idée : il montait chez un malheureux, y laissait la valeur de son billet de parterre, et rentrait chez lui, satisfait et bien payé de ce sacrifice.
On peut juger que les espérances d’un homme qui avait une faim si vive des réalités, ne pouvaient que croître avec l’âge. Aussi disait-il qu’entré dans sa soixantaine, en 1803, il avançait, grâce à Dieu, vers les grandes jouissances qui lui étaient annoncées depuis longtemps. Il se félicitait d’avoir connu, quoique tard, l’auteur du Génie du christianisme ; ce qui consolait sa religion de la perte récente de La Harpe. Il avait eu des avertissements d’un ennemi physique, le même que celui qui avait enlevé son père, mais il était loin de s’en affliger ; et la Providence, disait-il, l’avait toujours trop bien soigné pour qu’il eût autre chose que des grâces à lui rendre. La vue d’Aunay, près de Sceaux où il possédait un ami, lui avait toujours offert des beautés naturelles qui élevaient son esprit vers leur modèle, et le faisaient soupirer, comme les vieillards d’Israël, qui, en voyant le nouveau Temple, regrettaient les charmes de l’ancien. Une semblable idée l’avait suivi dans tout le cours de ses années ; et son vœu était de la conserver jusqu’au bout.
Il semblait pressentir sa fin. Un entretien qu’il avait désiré avoir avec un mathématicien profond sur la science des nombres, dont le sens caché l’occupait toujours, eut lieu en effet avec M. de Rossel, par l’entremise de l’auteur de cette notice. Il dit, en finissant : « Je sens que je m’en vais : la Providence peut m’appeler ; je suis prêt. Les germes que j’ai tâché de semer fructifieront ; je pars demain pour la campagne d’un de mes amis : je rends grâces au Ciel de m’avoir accordé la dernière faveur que je demandais. » Il dit alors adieu à M. de Rossel, et nous serra la main. Le jour suivant, en effet, il se rendit à la maison de campagne de M. le comte Lenoir La Roche, à ce même Aunay qu’il avait tant aimé. Après un léger repas, s’étant retiré dans sa chambre, il eut une attaque d’apoplexie. Quoique sa langue fût embarrassée, il put cependant se faire entendre de ses amis, accourus et réunis auprès de lui. Sentant que tout secours humain devenait inutile, il exhorta tous ceux qui l’entouraient à mettre leur confiance dans la Providence, et à vivre entre eux en frères, dans les sentiments évangéliques. Ensuite il pria Dieu en silence ; et il expira sans agonie et sans douleur, le 14 octobre 1803.
[….]