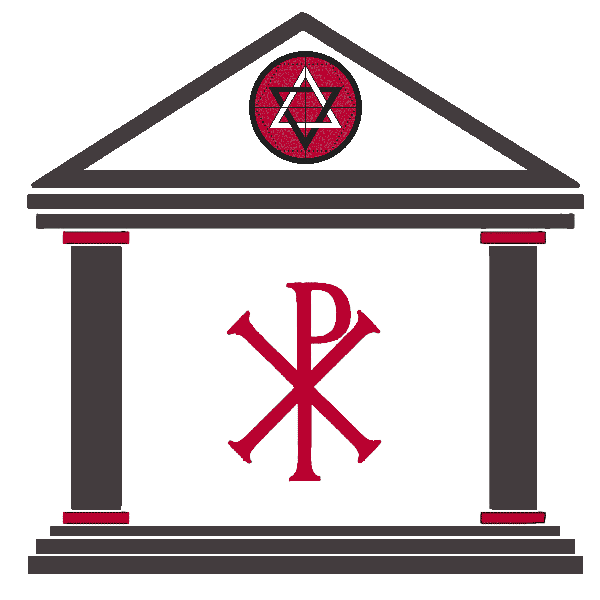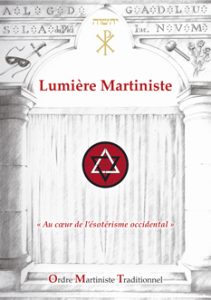Extrait du bulletin mensuel n° 395 de l’Ordre Martiniste Traditionnel.
«L’existence du mal et de la souffrance constitue sans nul doute la dure pierre d’achoppement de la réflexion philosophique sur l’homme et sur le monde dont celui-ci est partie intégrante ; chacun de nous n’aura pas manqué, tôt ou tard, de se trouver face à ce problème, au cours de l’adolescence notamment.
Si les formes du mal sont multiples, elles peuvent toutes s’ordonner en trois grandes catégories, ainsi que les a classées Leibniz dans sa “Théodicée” au paragraphe 21 : “On peut prendre le mal métaphysiquement, physiquement et moralement. Le mal métaphysique consiste dans la simple imperfection, le mal physique dans la souffrance et le mal moral dans le péché”. Pourtant, les souffrances de toutes sortes se ramènent, semble-t-il, à cette racine fondamentale : l’homme, comme apparemment toutes les créations de ce plan-ci, est tôt ou tard sujet aux conséquences inexorables d’une limitation radicale. Mais il y a plus, car ce que nous appelons “le mal” n’existe pas, semble-t-il, chez l’être humain seul : d’où l’idée, chez certains théosophes chrétiens comme Jacob Boehme, d’une participation de la création visible tout entière à la chute du premier homme.
Le but de cet exposé est de nous interroger sur la manière même dont les traditions secrètes significatives, celles du moins dont l’historien spécialisé peut aisément connaître les formations, se sont efforcées de résoudre le redoutable problème du mal et de la souffrance.
C’est sans doute chez les gnostiques chrétiens des premiers siècles que nous pourrions trouver les témoignages traditionnels les plus pathétiques sur la misère de l’homme “jeté” dans le monde : ce sont des textes comparables par leur intensité lyrique, aux descriptions si terribles que l’on rencontre chez certains philosophes existentialistes contemporains. Chez les gnostiques chrétiens comme chez Jean-Paul Sartre par exemple, on trouve cette terrible expérience métaphysique de la Nausée au sens sartrien du mot, c’est-à-dire la soudaine prise de conscience par l’homme du caractère “absurde” de ce monde où nous avons été littéralement jetés. Pourtant, l’existentialisme athée s’enfermera dans cette expérience humaine de l’absurde – d’autant plus poignante qu’elle est paradoxale au fond, car si l’existence même est absurde, sans raison d’être concevable, comment peut-on alors expliquer que la conscience humaine puisse en rendre compte ? Cela suffit à introduire dans le monde quelque chose qui se pose comme le contraire même de l’absurde, car la conscience se veut un moyen d’organiser le chaos.
Les gnostiques chrétiens, au contraire, se posaient le problème à leur manière d’une explication possible de cette absurdité existentielle du monde. D’ailleurs, leur phénoménologie instaurait quelque chose de plus : le monde n’est pas réellement “absurde” par lui-même, bien au contraire, puisqu’il semble (aux yeux de l’expérience gnostique) révéler l’action de forces permanentes perverses, mauvaises, destructrices. La mort, les souffrances si diverses, les horreurs innombrables qui prolifèrent ici-bas ne peuvent – constataient nos gnostiques chrétiens – qu’avoir une cause première. Et nombre d’entre eux allaient ainsi jusqu’à faire de la création sensible tout entière l’œuvre déplorable d’un Démiurge mauvais, ou tout au moins très inférieur à la Divinité lumineuse, conçue, elle, comme transcendante au monde absolument sensible et donc totalement irresponsable de son existence.
Robert Ambelain, dans son étude “Adam, Dieu Rouge” (Paris, Niclaus 1941, p. 17, 18), caractérise fort bien cette attitude gnostique face au scandale du mal et de la souffrance : “II semble en effet qu’une force créatrice formidable, aux possibilités titanesques, soit à l’œuvre ici-bas, sans répit. Mais cette force paraît dénuée de la perfection qui serait son apanage si elle était de source divine. La sagesse ne l’inspire pas, l’omniscience lui fait défaut. Elle tâtonne, procédant par essais successifs, créant une espèce pour en détruire une autre, mettant en action un principe pour en annihiler un second. Aveugle, elle n’est pas raisonnable, mais instinctive. Les sentiments élevés lui sont étrangers, elle est amorale. Ainsi la souffrance l’indiffère, la cruauté est sa loi souveraine. Créant sans raison, détruisant sans motif, elle fait souffrir inutilement” – attitude pessimiste qui tendra sans cesse à reparaître, et qui, jusqu’à nos jours, se combine tout naturellement à une pathétique prise de conscience du sombre mystère de la Chute originelle. On connaît les vers célèbres de Lamartine, qui constituent sans doute l’une des plus courantes et des plus précises définitions de l’attitude gnostique qui s’éveille au spectacle de l’être humain, tel que nous le connaissons avec toutes ses pauvres limitations : “Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l’homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux”.
C’est pourquoi l’historien découvrira dans les traditions ésotériques toute une série de pratiques magiques, thaumaturgiques, destinées à atteindre la réintégration de l’homme dans toutes ses prérogatives d’avant la Chute. C’est le fondement même de l’alchimie, tout spécialement, avec sa grande quête de l’immortalité adamique retrouvée.
Pour les gnostiques chrétiens, le scandale suprême ne pouvait qu’être l’emprisonnement de l’âme lumineuse dans un corps animal. Voici, à ce sujet, un texte manichéen (cité par Simone Pètrement, p. 185 de son livre “Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichéens”, P.U.F., 1947) : “Ô Dieu de lumière, chère âme ! Qui a obscurci ton œil lumineux ? Sans cesse tu tombes d’une misère dans une autre, et cela même, tu ne le reconnais pas. Et qui t’a de ta magnifique terre divine conduite en exil et qui t’a enfermée dans cette sombre prison ?”.
Le monde sensible, dans son ensemble, se trouvera vu par le gnostique comme une vaste prison, close sur elle-même. Citons un texte gnostique copte, la “Pistis Sophia” (126-319) : “Les ténèbres extérieures sont un grand dragon, dont la queue est dans sa gueule ; elles sont au-delà du monde, et elles entourent le monde entier”. C’est l’une des significations précises d’un symbole alchimique traditionnel : le serpent ou dragon Ouroboros. Les gnostiques ne manquaient évidemment pas de se référer à certains textes de l’Évangile, comme Jean (XVIII, 36) : “Mon royaume n’est point de ce monde…” ; ou comme cet autre passage dans la première Épitre (II, 15, 16) de saint Jean : “N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux, et l’orgueil de la vie, tout cela n’est point du Père mais c’est du monde…”. Ceci eut pour conséquence logique l’ascétisme si rigide de maints gnostiques chrétiens, qui s’appuyaient sur le célèbre texte de saint Matthieu (XIX, 12) : “Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, en vue du royaume de Dieu”. Peut s’y ajouter la condamnation de la sensualité s’exprimant sans détour dans les apocryphes gnostiques, comme l’“Évangile des Égyptiens” (l’un des textes coptes retrouvés à Nag-Hamadi, en Haute-Égypte) dans cette déclaration : “Et Marie Salomé demanda au Seigneur : Maître, quand finira le règne de la mort ? et Jésus répondit : lorsque vous autres femmes, ne ferez plus d’enfants… lorsque vous aurez déposé le vêtement de honte et d’ignominie, lorsque les deux deviendront un, que le mâle et la femelle seront unis, qu’il n’y aura plus ni homme ni femme, alors finira le règne de la mort”.
Nous retrouvons ici la doctrine ésotérique traditionnelle qui fait coïncider la pleine régénération de l’être humain avec la reconquête de l’androgynat céleste, puisque la séparation (sur ce plan-ci) des sexes avait résulté de la Chute originelle de l’Homme. Le dualisme total étant, malgré tout, une position métaphysique difficilement tenable, rien d’étonnant à ce que les traditions secrètes se soient efforcées de passer au-delà des antagonismes, de rechercher l’illumination totale qui rendrait compte du mal et de la souffrance.
Les gnostiques avaient développé divers systèmes leur permettant de donner une raison d’être à la Chute : par exemple, l’idée simple et grandiose d’une émanation divine au fur et à mesure que les formes s’éloignent de leur source première (la lumière inconcevable, l’Infini) ; celles-ci sont de moins en moins parfaites, d’où la dégradation continue du manifesté, la limite extrême en étant la matière inférieure, où règnent le mal, les ténèbres, la mort. Tel était du moins, dans le gnosticisme chrétien, l’une des explications métaphysiques les plus commodes, qui rejoignaient la doctrine des néoplatoniciens d’Alexandrie. Avec une telle conception, l’idée si terrible d’un mal “absolu” pouvait être finalement évitée. Laissons la parole au Pseudo-Denys l’Aréopagite dans son traité sur les “Noms divins” (chapitre IV, paragraphes 29 et 33, p. 123 et 125 de la traduction de Maurice de Gandillac publiée aux Éditions Aubier) : “Tant que la privation du bien n’est que partielle, nous n’avons pas encore affaire au mal, et si elle devient totale, la nature même du mal s’est évanouie… Le mal n’existe pas par soi si on le suppose sans mélange avec le bien”.
Le fait même de prendre conscience de l’existence, de l’inquiétante prolifération du mal et de la souffrance dans le monde où nous vivons (celui des apparences sensibles) pourra même – si nous savons trouver le fil d’Ariane – nous mettre sur le chemin de la vraie connaissance, celle qui sera en même temps salut et libération de la conscience. Voici un fort beau texte attribué à Simon le Magicien, et cité par Hippolyte de Rome (Philosophoumena, VI, I, 15) : “Elle est amère, en effet, l’eau qu’on trouve après la mer Rouge : car elle est la voie qui mène à la connaissance des choses de la vie, voie qui passe à travers les difficultés et les amertumes. Mais, changée par Moïse, c’est-à-dire par le Verbe, cette eau amère devient douce”.
Et nous pourrions peut-être citer ici les paroles célèbres du Bouddha : “C’est le désir, exigeant toujours, qui produit la renaissance accompagnée d’un attachement passionné, d’une attirance pour la vie dans cette forme ou une autre, c’est-à-dire du plaisir sensuel, de l’existence ou de l’annihilation”. On conçoit mieux alors l’accent mis, dans les voies initiatiques, sur cette clé libératrice fondamentale qui consiste en l’apprentissage du “détachement” – attitude humaine qui se distinguera d’ailleurs tout à fait de l’indifférence banale. Avec une telle attitude, il deviendra possible à l’illuminé de continuer à vivre dans les apparences sensibles sans être (nuance capitale) dominé par elles ; comme dit un adage tantrique de l’Inde, il s’agit pour le sage de “parvenir à cueillir le lotus sans se mouiller la main”. Et ce détachement de la conscience par rapport aux conditionnements mêmes de ce plan inférieur rendra possible l’illumination, seule capable de nous faire enfin com- prendre la raison d’être ontologique de l’existence du mal, de la souffrance, et plus généralement parlant, des apparences sensibles elles-mêmes. Dans la “Pistis Sophia”, nous avons ce texte splendide : “Le mystère de l’ineffable connaît pour- quoi est la sévérité et pourquoi la miséricorde ; et ce mystère, c’est lui qui connaît pourquoi est la perdition et pourquoi est l’existence éternelle dans les siècles”. Cette illumination totale, libératrice, est superbement décrite par exemple dans les Oracles de Zoroastre (texte du IIIe siècle de notre ère) : “Quand tu verras le feu sacré sans forme (brillant en dansant dans l’abîme du monde entier), écoute la voix du Feu”.
Le Feu, c’est la lumière libératrice. Dans ce beau texte, il deviendra possible de comprendre enfin la raison d’être laissée au négatif par le Plan divin. Pour la Kabbale, le mal apparaîtra comme l’une des activités divines constitutionnelles, indispensable à l’harmonie de l’ensemble (de même que pour prendre une image familière, les ombres et les tonalités sombres sont indispensables à la réalisation d’un tableau) : la “mauvaise tendance” (“Yetser Hara”) sera, dans la création, conçue comme le pendant de la “bonne tendance” (“Yetser Tob”).
Nous retrouvons ici la doctrine complémentaire ésotérique traditionnelle de l’indissoluble union, sur le plan de la manifestation, des deux polarités complémentaires ; l’une des figurations symboliques en sera ce qu’on appelle le pavé mosaïque, aux carreaux alternativement blancs et noirs. Intuition illuminatrice totale qui pourrait être illustrée par ces mots d’André Breton, dans le “Second manifeste du surréalisme”, où nous trouvons ce passage : “Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement”.
Mais il conviendrait, pour conclure, de méditer avec fruit ce passage du Zohar (l’un des deux grands traités kabbalistiques) : “La doctrine secrète est pour les sages. Les âmes agitées et sans équilibre ne la peuvent concevoir…”.
Si donc l’illumination métaphysique lui fait comprendre enfin la raison métaphysique de l’existence des choses négatives, – car il verra les choses dans leur ensemble, et non plus par séries, éléments séparés –, l’initié n’en viendra aucune- ment à une bien commode attitude d’indifférence vis-à-vis des conséquences éventuelles de ses actes. Comprenant la raison d’être des choses négatives, l’illuminé n’en fera pas moins en toute sincérité le choix positif de contribuer à construire, à organiser : instaurer l’ordre à partir du chaos, et ce, dans tous les domaines où il lui sera donné d’agir. »